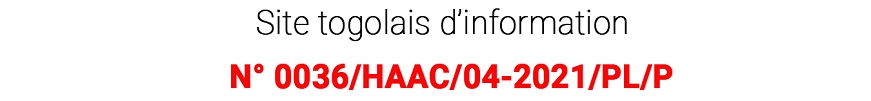GNASSINGBE Eyadéma : retour sur le parcours d’un homme qui aura durablement marqué l’histoire politique togolaise

Le régime Eyadema commence le 14 avril 1967. Il est intervenu dans un contexte de crise politique qui secouait le régime Nicolas Grunitzky. Il est marqué essentiellement par l’instauration du parti unique en 1969, visant à construire l’unité nationale et les efforts pour faire décoller économiquement le pays par certaines réalisations socio-économiques et culturelles, à partir de 1974.
Au cours de l’année 1966, Nicolas Grunitzky et Antoine Idrissou Méatchi (à qui l’on avait confié la gestion du pays après l’assassinat de Sylvanus Olympio), se livrent une guerre d’usure, plongeant le Togo dans une crise. Pour finir avec les conflits de leadership créés par le bicéphalisme Grunitzky-Méatchi et éviter les divisions, Eyadema Gnassingbé intervient de nouveau le 13 janvier 1967. Il fit régner l’union et la paix entre les Togolais.
Qui est Eyadema Gnassingbé, et quel est son parcours ?
Né en 1935 à Pya dans la préfecture de la Kozah, il fut engagé volontaire au Dahomey par l’armée française le 20 mai 1953 ; et fut envoyé en Indochine (entre 1954 et 1956), en Algérie (entre 1956 et 1957) puis au Dahomey (entre 1957 et 1959). Il servit quelques temps (1962) au Niger avant de revenir au Togo le 1er septembre 1962 avec le grade de sergent-chef.
Il fut promu respectivement lieutenant le 1er février 1963, capitaine le 1er octobre 1963 et commandant le 1er octobre 1964. Il est devenu Chef d’État-major général des Forces armées togolaises (FAT) le 1er octobre 1965 avec le grade de lieutenant-colonel. C’est sous ce grade qu’il devint président de la République le 14 avril 1967. Il devint colonel en 1968 et général le 23 juin 1976.
La prise du pouvoir par Eyadema Gnassingbé visait la paix et la construction de l’unité nationale. Il prit donc des mesures pour apaiser le climat politique et amorcer l’unité et la réconciliation nationales, en libérant, par décision du 26 avril 1967, les détenus politiques et les internés administratifs des régimes précédents.
En mai 1967 ; il dissout tous les partis politiques. Le 11 juillet 1967, il décidé d’une amnistie générale, et le 4 décembre 1967, il instaure une journée de réconciliation nationale.
Entre 1965 et 1970, face aux crises que connaissaient les pays nouvellement indépendants, il apparut aux yeux des stratèges occidentaux, que la solution serait l’adoption de régimes politiques forts, appuyés par des partis uniques imposant un développement contrôlé pour sortir du marasme.
Une solution qui paraissait si séduisante qu’elle sera rapidement adoptée et appliquée par bon nombre d’États dont le Togo. C’est dans ce contexte qu’après de nombreuses consultations, le chef de l’État convie, le 30 août 1969 à Kpalimé, tous les Togolais à se rassembler dans un même creuset national.
Du 12 au 14 novembre, il tient dans la même ville de Kpalimé, le premier congrès statutaire du Rassemblement du peuple togolais (RPT). L’idéologie et le programme de développement du parti, largement exposés dans le ‟livre vertˮ, sont un modèle d’humanisme.
Les ailes marchandes
La Jeunesse du Rassemblement du peuple togolais (JRPT), l’Union nationale des femmes togolaises (UNFT), et la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT) sont destinées à encadrer le développement des masses laborieuses au service du développement du pays.
Dans la foulée, le parti décide d’imposer un nouvel hymne national au pays et d’imposer le 13 janvier comme fête de libération nationale. Le général Eyadema Gnassingbé fut légitimé comme chef de l’État au référendum du 9 janvier 1972. Le 24 janvier 1974, il sort indemne d’un accident d’avion à Sarakawa. Cet accident est considéré comme un coup de force de l’impérialisme occidental, et Eyadema décide nationaliser les phosphates du Togo.
La ‟victoireˮ sur l’impérialisme se célébra. À l’image du mobutisme, un modèle dont s’inspirent les stratèges du RPT, les instances dirigeantes adoptent les thèses de l’‟authenticitéˮ. Les mesures les plus visibles sont : l’abandon des prénoms dits importés (surtout chrétiens) et la généralisation de ceux du terroir togolais ; l’instauration des fêtes traditionnelles et de l’animation politique. À l’occasion, les jeunes (et les moins jeunes) chantent et dansent à la gloire du chef de l’État.
Eyadema Gnassingbé réussit à séduire la population, grâce à la paix, à la sécurité, et au mieux-être des Togolais entre 1970 et 1985. Il sera ainsi réélu à la tête de l’État (en 1972, 1979, 1986) au cours des consultations électorales dont il était le seul candidat.
Cependant le régime Eyadema a fait l’objet de plusieurs tentatives de déstabilisation. De même, le gouvernement Eyadema a été souvent accusé par les instances internationales de violations des droits de l’Homme et de répression de ses adversaires politiques. Mais, ses appuis internationaux, dont la France, ont toujours su lui éviter les condamnations de la communauté internationale.
Les principales réalisations sociales, économiques, et culturelles sous le régime Eyadema
Les réalisations sociales, économiques et culturelles sous le régime Eyadema ont véritablement commencé en 1974. Elles sont nombreuses, mais l’on peut retenir quelques œuvres essentielles.
Dans le domaine agricole, d’importantes mutations ont commencé par la réforme agro-foncière (avec l’ordonnance du 6 février 1974) destinée à libérer les terres au profit de tous les Togolais désireux de les mettre en valeur.
En 1977, la politique de la révolution verte fut lancée. Les infrastructures et les institutions agricoles telles que la Société de rénovation de la cacaoyère et de la caféière (SRCC) ; la Société togolaise du coton (Sotoco) ; la Société nationale des palmiers à huile (Sonaph), l’Office du développement et d’exploitation des forêts (Odef) furent mises en place dans les années 70. Pour promouvoir la conservation et la commercialisation des produits céréaliers, Togo-grain a vu le jour.
Le domaine industriel est marqué par la nationalisation de la Compagnie des mines du Bénin (CTMB). Par ailleurs, l’on assiste à la mise sur pied en 1978 du Centre national de promotion des petites et moyennes entreprises avec la naissance d’une Société togolaise d’hydrocarbure (STH) ; d’une Société nationale de sidérurgie (STS) et d’une usine de clinker à Tabligbo, gérée par une entreprise multiétatique (Cimao).
Le domaine touristique et hôtelier connut des améliorations. Des sites touristiques tels que les forêts classées de Missahohoé, d’Atilakoutsé, de Kpimé, le château Viale, les grottes de chauve-souris de Kévuvu et la cascade d’Aklowa furent aménagés. L’on peut citer aussi les réserves de Fazao-Malfacassa, de la Kéran et la fosse aux lions de Dapaong.
Dans le domaine hôtelier l’on peut citer l’hôtel du 2 février, l’hôtel de Sarakawa, l’hôtel de la paix, ainsi que plusieurs petits hôtels dans les grandes villes de l’intérieur du pays.
Quand est-il de la formation ?
À l’Institut supérieur du Bénin né en 1967, succéda l’université du Bénin, créé en 1970. En 1975, intervint une grande réforme de l’enseignement, destinée à mettre en place les conditions d’une formation idoine pour un avenir meilleur de la jeunesse togolaise.
Le secteur financier s’affermit et se développe, surtout au cours des années du boom du phosphate. De nouvelles structures bancaires internationales s’installent dans le pays.
Sous feu le général Eyadema Gnassingbé, du moins jusqu’en 1990, le pays prit de l’essor sur tous les plans. Le régime Eyadema tenta de construire la paix et l’unité nationale par la création d’un parti unique, le RPT. Mais le manque de démocratie et la mauvaise gestion plongèrent le pays dans la récession. Cela poussa le peuple à réclamer plus de liberté et de démocratie.
Avec M. TSIGBE N. Koffi, Professeur titulaire en histoire contemporaine à l’université de Lomé