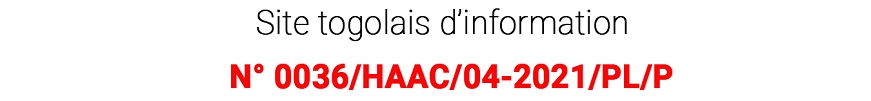Discours du Sénateur Kagbara au mini sommet sur le panafricanisme et la démocratisation à Abidjan

En marge du mini sommet sur le panafricanisme et le processus de démocratisation dans les États africains placé sous le thème : “Processus de démocratisation en Afrique du discours de la Baule à aujourd’hui : bilan et perspectives”, le sénateur Innocent Kagbara a dans un discours alléchant ajouté une contribution significative au sujet. Nous partageons avec vous l’intégralité de ce discours.

Monsieur le Président du Président du COJEP ;
Mes dames et Monsieurs / Membres du Gouvernement ;
Mes dames et Monsieurs / Présidents des partis politiques ;
Chers militants ;
Distingués invités à vos grades et qualités
C’est un honneur pour moi, de prononcer ce discours devant cette prestigieuse audience. Permettez-moi de vous entretenir sur l’idée d’africatie, une notion que nous avions forgée pour donner un nouvel élan à notre continent.
A l’occasion du dixième anniversaire du COJEP que nous célébrons ce concept a tout son sens. Interrogeons-nous. Que vaut le processus de démocratisation de nos Etats ?
En juin 1990, lors de la conférence de La Baule, le président français François Mitterrand lia explicitement l’aide au développement des pays africains à l’engagement vers la démocratie pluraliste. Ce discours fut un tournant symbolique, amorçant une vague de conférences nationales, de révisions constitutionnelles et d’élections pluralistes dans plusieurs États africains.
Quel bilan peut-on faire de cette conférence ?
Trente-cinq ans plus tard, le bilan est contrasté. Certains pays, comme le Bénin ou le Cap-Vert, ont consolidé des processus électoraux relativement stables.
Cependant, dans de nombreux États, les transitions ont débouché sur un multipartisme formel mais sans réelle alternance démocratique, avec la persistance de régimes néo-patrimoniaux et de logiques clientélistes. Les acquis majeurs restent la liberté d’expression accrue, l’émergence de la société civile et l’ouverture de l’espace politique.
En revanche, l’indépendance de la justice, l’alternance pacifique et la gouvernance économique transparente restent fragiles.

Que peut-on – dire des perspectives ?

Pour nombre de penseurs africains, il est nécessaire de dépasser la simple « copie » des modèles occidentaux. Achille Mbembe (2000) parle d’« afropolitanisme politique » qui intègre les dynamiques culturelles locales. Joseph Ki-Zerbo rappelait que « l’on ne développe pas l’Afrique sans les Africains » — une démocratie véritable doit donc s’enraciner dans les réalités sociales, linguistiques et communautaires africaines.
C’est dans cette perspective que s’inscrit ma réflexion sur la notion d’africratie. Cette vision propose un système parlementaire repensé, fondé sur trois piliers :
- Réforme et refondation institutionnelle : des institutions adaptées aux réalités africaines, valorisant les conseils communautaires et la médiation traditionnelle.
- Modèle économique souverain : basé sur la valorisation des ressources locales, l’agriculture modernisée et l’entrepreneuriat des jeunes.
- Vision, valeurs, vérification (3V) : une gouvernance évaluée régulièrement selon des critères culturels et éthiques africains.
Ainsi, l’africratie ne nie pas la démocratie, mais l’africanise : elle vise à dépasser le simple cadre électoral pour bâtir une gouvernance de proximité, participative et endogène.
En conclusion, si le discours de La Baule a marqué un point de départ dans la démocratisation africaine, la prochaine étape est la réappropriation de ce processus par les Africains eux-mêmes. L’africratie pourrait en être l’expression contemporaine : un modèle qui ne se contente pas d’importer des institutions, mais qui forge un pacte politique en phase avec les aspirations et l’identité du continent.
J’invite tous les africains à s’approprier du concept d’« africatie ». Je suis convaincu que la destinée glorieuse de l’Afrique s’y trouve.